-
IL Y A ENCORE DES CANNIBALES...
… IL Y A ENCORE DES CANNIBALES
UNE PRATIQUE QUI EXISTE DEPUIS TOUJOURS SUR TOUT LES CONTINENTS…
Le bouillon dégageait un arôme sucré. On voyait ses « yeux » larges à sa surface, car il n’était pas question, ce jour-là, de passer si peu que ce soit l’écumoire. Toute la famille avait assisté à sa présentation dans le plus profond recueillement. L’instant était venu, enfin, pour la mère ou pour la plus âgée des sœurs, d’en emplir un plein bol et de le porter, dévotieuse, à l’aîné des garçons. Celui-ci entamait son repas, épié par les autres, avec plus ou moins de vaillance.
Parfois il était pris d’une nausée, torturé d’un haut-le-cœur, car pour du bouillon gras, s’en était. Mais il se ressaisissait et reprenait, stoïque, sa lente ingestion. Ou bien il renâclait, il renonçait, il « calait ». Et c’était la catastrophe : il s’entendait déchoir, séance tenante, de son droit d’aînesse, victime de cet Esaü de la Bible qui paya, un jour, du même prix, sa fringale de lentilles. Mais qu’avait-elle donc de si important cette tasse de consommé ? Un détail dans la recette, simplement : on l’avait obtenu par cuisson lente d’un corps d’homme, celui du père décédé. Ce breuvage seul pouvait transmettre au nouveau chef de famille le courage, la sagesse et toutes les qualités, toutes les vertus du défunt. N’était-ce pas une raison suffisante pour mettre le feu papa à feu doux ?
Ainsi procédait-on, dans nombre de familles de la Chine antique, chaque fois que le deuil la frappait en la personne de son chef vénéré et incontesté. C’était un banquet funéraire plutôt frugal, mais riche de signification, de pouvoirs, et d’ailleurs imposé par les dieux. Ce cannibalisme-là n’avait rien de spécialement gastronomique ; c’était un rite pieux, au contraire, basé sur des certitudes que l’on retrouve dans bien des contrées du globe, en bien des époques de l’Histoire. Car le cannibalisme – l’anthropophagie comme les ethnologues préfèrent l’appeler – à beaucoup sévi de par le monde. Avec ses aspects spécifiques et traditions propres pour chaque groupe. Dessins humoristiques aidant, les Européens s’en font souvent une idée fausse et saugrenue qu’ils en arrivent à nier sa réalité. Il s’agit toujours de gros Noirs (c’est donc de l’humour noir ?) employés à tourner à la broche, ou à mitonner dans une marmite, un explorateur blanc proprement ficelé, avec tous ses vêtements encore et son casque bien vissé sur la tête. A croire que le cannibalisme est contemporain de l’ère coloniale. Alors qu’il est antérieur… à l’homme lui-même. A condition d’admettre, bien sûr, que l’homme descende du singe. Les anciens singes, oui, se dépeçaient les uns les autres, s’étripaient à quatre mains et se dévoraient entre-eux. Leurs descendants ont renoncé, semble-t-il, à cette coutume patriarcale. Les hommes se mirent à en faire autant, et ce furent, sans doute, leurs toutes premières singeries d’une histoire qui ne finirait jamais. On a pu établir que la consommation de chair humaine avait une certaine importance dans le paléolithique, qu’on avait ouvert des boucheries anthropophagiques, ou leurs équivalents, à l’âge de pierre, soit 12000 ans avant notre ère.
Des preuves formelles ont été recueillies sur l’époque du Néolithique (la période de l’ère quaternaire qui va de 5000 à 2500 avant J.-C., grâce à des fouilles pratiquées sur l’emplacement d’antiques cités lacustres. On devait constater, enfin, avec une certaine stupeur de ce type. Des hommes de tous les groupes ethniques, de toutes les origines, se sont entredévorés, au point qu’il faudrait réclamer l’internationalisation du vieux dicton : « L’homme est un loup pour l’homme ». L’étude de ces questions peut s’effectuer, à ce compte, continent par continent. Des preuves de « cannibalisme européen » ont été recueillies à Cheveau, en Belgique : des ossements d’adolescents et de femmes ramenés au jour portaient des traces évidentes de cuisson, de préparation culinaire. En Yougoslavie, sous une roche de Zagreb, on a découvert les restes de 21 hommes ou femmes dont il était évident qu’ils avaient été, en d’autres temps, « inscrits au menu ». On a pu noter, plus spécialement, que les os de grande dimension étaient fracturés et brûlés, que le crâne avait été fendu pour permettre l’extraction de la cervelle, ce morceau de choix. En ce qui concerne les Romains, c’est plutôt aux textes qu’il faut se référer. On pense qu’ils pratiquaient surtout les sacrifices humains – à caractère alimentaire – au temps des moissons, des récoltes, des vendanges pour témoigner d’une certaine idée d’opulence. L’Empereur et historien Gallien (du IIIème siècle de notre ère) a laissé des récits extrêmement précis à cet égard. Nous trouvons plus proche encore : au IVème siècle, les Attacottes, peuplade bretonne, se nourrissaient volontiers de chair humaine. En gourmets, semble-t-il, et avec une prédilection pour les seins des vierges et les fesses des adolescents.
Au 8ème siècle, sur les territoires qui constituent les actuelles Roumanie et Yougoslavie, on procédait dans un tout autre esprit : on mangeait – quitte à les déterrer – les cadavres des suspects de vampirisme. C’était, paraît-il, un vaccin pour ne pas devenir vampire soi-même. La même croyance se retrouvait dans les Balkans, au 18ème siècle. Mais il existait déjà, sur ces territoires, un long passé de cannibalismes : à l’époque du Moyen Age, des sorciers et des sorcières mangeaient en cachette la chair de jeunes enfants. Mais pas entièrement : ils gardaient la graisse pour les mystérieuses onctions pratiquées dans les cérémonies de sabbat. Les 13ème siècles italien vit les « hérétiques » des deux sexes s’assembler de nuit pour chanter des hymnes. Mais, à un moment donné, ils ne chantaient plus ; ils éteignaient les chandelles et s’accouplaient dans l’obscurité, au hasard d’une bizarre partie de « catch catch ». Les hérétiques se retrouvaient neuf mois après cette première réunion. Ils s’appliquaient à déterminer le premier-né d’entre ces enfants issus de la nuit d’orgie et de folles passions, aveugles par définition. Quand on l’avait trouvé, on se le passait de main en main, sans trêve ni répit, jusqu’à ce que lassé de ce jeu il préférât vendre l’âme. Son dernier soupir avait beaucoup de valeur : celui qui tenait l’avorton dans ses bras au moment du décès devenait le « Grand Pontife » pour toute la durée d’un nouvel exercice. On l’acclamait, on brûlait le petit corps, on mêlait ses cendres à du vin, et tout le monde s’en envoyait une gorgée en signe de joyeux avènement. Quant aux autres rejetons nés de « l’accouplement sacré » on les épargnait. C’était pour mieux les mangés, ces enfants. Mais quelques mois plus tard, au cours d’agapes rituelles. L’odeur de la chair fraîche paraît s’être installée, plus spécialement, au cours des siècles passés, sur le bassin méditerranéen. Mais il serait injuste d’ignorer les Gitans, en leur perpétuelle errance. Ils ont aussi leur mot à dire, en pareille matière, et voici ce qui se passait chez eux, il n’y a pas si longtemps encore (mais l’a-t-on vraiment prouvé ?) pour assurer la pérennité des dynasties :
Quand la reine disparaissait, celle qu’on désignait pour lui succéder devait déguster, d’abord, un morceau de l’intestin prélevé sur la chère disparue. Le sens de ce geste était, cette fois encore, d’hériter de la sagesse et de l’expérience. Le « nouveau monde » est moins prodigue d’exemples ; mais il en existe malgré tout. Au Mexique, on servait volontiers des morceaux (fins) de chair humaine aux seigneurs locaux, sur des plateaux d’or et d’argent. Tête des conquérants espagnols quand ils furent conviés à de telle félicités ! Au Brésil, les Catagnas des rives du Magui mangeaient leurs morts après les avoir accommodés selon des recettes éprouvées et très élaborées. C’était la meilleure manière, disaient-ils, de conserver d’eux un aimable et même savoureux souvenir. Et l’on s’épargnait la peine d’avoir des cimetières. En Asie, les points chauds du cannibalisme furent toujours, par tradition, la Birmanie, l’Inde, l’Insulinde et la Chine. Marco Polo (1254-1323) s’étonnait déjà de certaines tribus du Nord, dans l’actuelle Birmanie, qui, disait-il, mangeaient la chair de tous les hommes qui n’étaient pas morts de mort naturelle. Et de préciser que les guerriers de ces mêmes territoires n’aimaient rien tant que de boire le sang chaud de leurs ennemis défaits au combat. En Inde et dans le Pakistan les choses prennent encore un aspect différent : il semble bien que le cannibalisme s’y soit encore pratiqué, dans certaines régions au 19ème siècle, d’une façon quasi usuelle. Au temps, donc, de la présence britannique. Il est vrai que dans le même temps on épargnait les vaches, sacrées ou non. Les Kafirs, au nord-ouest du sous-continent, mangeaient un morceau du cœur de l’ennemi qu’ils venaient de tuer et buvaient un peu de son sang. C’était, bien sûr, sa force, son courage, qu’ils entendaient lui ravir. Quant aux pratiques de telle ou telle secte, dans ces territoires qui en comptent par centaines, que ne pourrait-on en dire ?
En 1931, trois Brahmanes d’une grande piété furent traînés en justice : on les accusait d’avoir déterré le corps fraîchement inhumé d’un enfant, de l’avoir accommodé selon certaines préparations, et mangé enfin. Les accusés avouèrent ces faits dans leur intégralité. Mais ils affirmèrent bien haut qu’il s’agissait d’un rite religieux. Lequel ? On ne l’a jamais su. Car aucune des religions indiennes ne préconise de tels usage ; et toutes, ou presque, recommande à leurs adeptes le régime végétarien. C’est avec la lointaine Océanie, semble-t-il, que la pratique du cannibalisme s’apparente le mieux avec l’art de mettre les petits plats dans les grands. Là-bas on ne dévore pas ses victimes, on les déguste, en raffinés que l’on est. Nous le disons au présent, car il semble que ces parties fines n’aient pas encore totalement disparu. Mais allez savoir ! Les préférences vont à la triperie. Les morceaux les plus recherchés sont le foie, le cœur et la langue. Mais aussi la main droite (pour les non gauchers). Le fin du fin est d’arroser le tout d’une rasade de sang frais du meilleur cru. On ne néglige pas le reste pour autant, mais on le classe, par tradition, dans le « second choix ». Le symbolisme, l’animisme ressurgissent avec le monde des Canaques. Chez eux, les mains, le cœur et le cerveau des victimes sont réservés aux guerriers. Mais encore faut-il se ravitailler, faire son marché comme l’on peut. Dumont d’Urville, dont les voyages se situent au début du dernier siècle, rapporte qu’à l’Île de Fiva, dans l’archipel des Fidji, les habitants se faisaient la guerre d’un village à l’autre, uniquement pour faire des prisonniers et les manger. Aux époques de grandes fêtes ils souffraient souvent d’une pénurie, ou, en tout cas, d’une insuffisance de prisonniers pour célébrer dignement l’évènement. Alors ils faisaient la part du feu (de cuisson) : ils massacraient leurs épouses pour augmenter les réserves et ne pas risquer de rester sur leur faim. La pratique était admise, respectée, approuvée. Il se trouva même un jour de quasi-disette où le vieux chef Thamao exigea que fussent immolées sans plus de manières les trente premières femmes rencontrées. Celles-ci trouvèrent tout à fait normal de participer à ce quasi « service public ». Elles savaient qu’une fois immolées les membres de leurs familles ne seraient pas les derniers à leur rendre honneur, si l’on ose s’exprimer ainsi. Ce fut, d’ailleurs, le cas.
Le capitaine Cook avait aussi sa part de bonnes adresses, de cannibalisme quatre étoiles. Mais il les trouvait ailleurs. Il nous parle des Papous et de leur art de répartir les bons morceaux au lendemain d’un affrontement : le foie, le cœur et les muscles pour les hommes, qui n’en auront jamais de trop, après tout. Et puis, tout au bas de l’échelle des valeurs, des cervelles pour les femmes qui en ont grand besoin comme chacun sait. Hélas, ces cervelles étaient impures, dans bien des cas : elles transmettaient un virus, la rickettsiose, assez semblable à celui de la sclérose en plaques. Bons princes, les farouches guerriers renoncèrent, un beau matin, à rester anthropophages. Mais ne quittons pas le monde austral. Il possède ses histoires contemporaines : en 1961, en Nouvelle-Guinée, deux indigènes ont dégusté un jeune anthropologue, Michaël Rockefeller. C’était à peu près au moment où les Balubas d’Afrique inscrivaient à leur menu deux soldats de l’O.N.U. sans aucun respect pour leur casque bleu. L’Afrique, d’ailleurs, pour conclure l’énumération, reste, au dire des spécialistes, la terre de prédilections des mangeurs d’hommes. Mais les convives n’ont pas toujours les mêmes motivations. Si l’on en croit le naturaliste le Vaillant (1753-1824) dans plusieurs contrées les indigènes mangeaient leurs vieux parents, une fois atteint un certain nombre de lunes, pour leur éviter ces hospices qu’ils n’avaient pas inventés. Dans la partie méridionale, l’une des plus grandes satisfactions des jeunes guerriers était de savoir que, s’ils venaient à mourir au combat, ils ne seraient pas mangés par le vulgum pecus mais par les chefs seulement, honneur sans pareil. Plus au nord, on peut citer des tribus qui, la guerre finie, dévoraient leurs prisonniers pour être sûrs non seulement qu’ils ne s’évaderaient pas mais encore que leurs fantômes ne viendrait pas se venger. Il y aurait long à dire, enfin, sur les négociants spécialisés dans la fourniture de chair humaine. On hésite à employer les mots de « chevillards » ou autres grossistes.
Mais, où que l’on soit, que de manières de considérer le cannibalisme ! Pour certains il s’agit, en mangeant le corps, de détruire l’âme et de se tenir, du même fait, à l’abri des esprits. Pour d’autres il s’agit avant tout de « récupérer », de s’approprier le bien d’autrui. Dans la seconde catégorie s’inscrivent des vieillards d’un peu partout qui mangent les seins de jeunes femmes en guise d’aphrodisiaque, et des aïeules qui réservent le même sort à certains morceaux virils qui ne sont bas que par l’emplacement. Ces recettes de jouvence ne valent rien du tout. Nous le précisons fermement, dans notre souci de n’éveiller aucune fâcheuse vocation. Car il reste un risque sérieux de voir le cannibalisme renaître. On y pense, plus spécialement, depuis de récentes expériences de laboratoires réalisées sur les « planaires ». Ces « planaires » sont des vers plats dotés de cerveaux assez évolués. On les a soumis, en laboratoire, à un entraînement de forme classique des réflexes conditionnés : au bout de quelques séances une lumière qui scintillait suffisait à les faire agir de telle ou telle manière. Mais on les a massacrés, ensuite. Et l’on a donné leur chair en pâture à quelques uns de leurs semblables. Le résultat fut stupéfiant : ces mangeurs acquirent eux-mêmes les réflexes conditionnés ; ils avaient acquis de la mémoire, de l’intelligence par simple ingestion et digestion.
Alors on se prend à trembler : va-t-on s’entredévorer de plus belle, en notre siècle, avec ce souci nouveau de se voler l’intellect ? Encore un peu et c’est parmi les membres de l’Institut que l’on emploiera le plus souvent l’expression « numéroter » ses abattis ».
*
Source- Nostra n°212 d’avril 1976
-
Commentaires
1pierreDimanche 29 Avril 2012 à 07:44ho la la que j'aimerais qu'un endroit peuplé de femmes cannibales existe ,je m'y rendrais avec plaisir pour connaître le bonheur absolu de finir en beauté.Tout de même plus agréable de finir dans des tripes de nanas ,plutôt qu'un cercueil et un trou dans la terre.Finir digéré par des femmes ah oui et avec plaisir,ci je savais où trouver cela je m'y rendrais de suite et sans réfléchir ,mais un tel paradis de se trouve pas.Répondre Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
 Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Gardez l'œil ouvert et le bon si possible... + de 4 millions de visites !


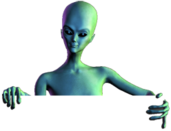





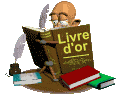

 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot



